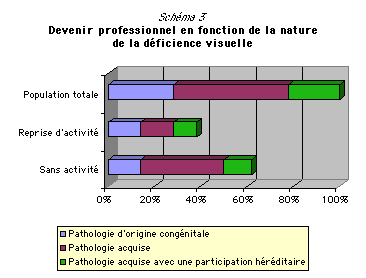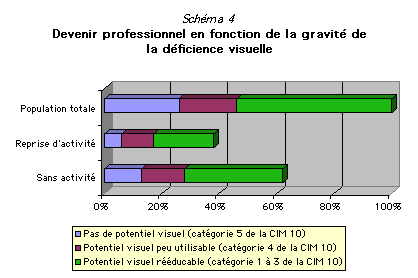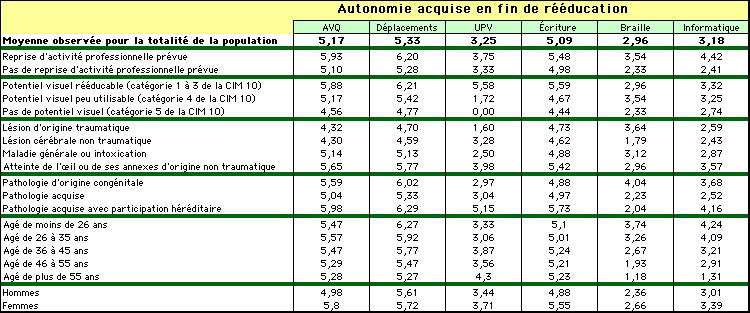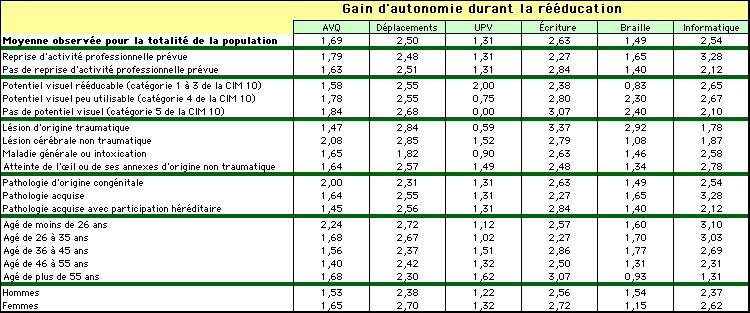L'EMPLOI DES ADULTES
Déficients Visuels
Le devenir professionnel des déficients visuels après rééducation
Évolution de la situation professionnelle
des patients déficients visuels reçus en rééducation
sur 15 ans.
Les personnes adultes qui deviennent, au cours de leur vie aveugles ou malvoyantes perdent, totalement ou en partie, des possibilités visuelles mais conservent leur expérience professionnelle. Cette donnée essentielle bien que triviale a longtemps été négligée. Les premiers efforts de réadaptation des déficients visuels ont consisté à définir, puis orienter systématiquement les sujets vers des "métiers d'aveugles", souvent peu qualifiés, répétitifs et sans rapport avec les compétences ou les motivations professionnelles des personnes concernées.
Si aujourd'hui la rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle sont beaucoup plus personnalisées, quels sont les résultats obtenus, la nature des emplois occupés et la proportion de reprise d'activité ? L'expérience professionnelle initiale est-elle prise en compte, par quels moyens et dans quelle mesure ?
- 1 - Population de référence de cette étude
L'étude des 855 personnes qui ont effectué une rééducation dans l'Unité 1 du CRFAM (Centre de Rééducation Fonctionnelle de Marly-le-Roi), d'octobre 1987 à octobre 2002, permet d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions.
- Ces 855 personnes ont suivi une rééducation fonctionnelle dans notre centre, d'une durée moyenne de 81 jours.
- On compte parmi eux 513 hommes et 342 femmes, avec un âge moyen de 37,6 ans.
- 26% sont totalement aveugles (catégorie 5 de la CIM 10) et 74% sont malvoyants. Plus précisément, 20% ont des possibilités visuelles très limitées (catégorie 4 de la CIM 10), et 54% ont conservé des possibilités visuelles plus fonctionnelles (catégorie de 1 à 3 de la CIM 10).
NB. Pour connaître plus précisément les caractéristiques de cette population, il est utile de consulter l'étude récente, réalisée à partir d'une cohorte de 931 patients hospitalisés dans le service entre janvier 1986 et octobre 2002
Cette présente étude est transversale et non longitudinale. C'est-à-dire que ce qui est pris en compte est l'évolution de la situation professionnelle pendant la rééducation. Si la situation professionnelle antérieure (avant le handicap et/ou un an avant le début de la prise en charge) est connue, le devenir professionnel est celui qui est prévu en fin de rééducation. Il s'agit, dans un grand nombre de cas, d'une décision ferme de la part du sujet, de l'employeur ou du centre de formation concerné, mais pas encore d'une situation vécue. L'objectif n'est donc pas de suivre le devenir professionnel à 3 ou 5 ans après rééducation, mais de relever les types d'orientations, de réorientations ou d'aménagements de poste souhaités par les sujets et mis en place pendant, et grâce, aux résultats de la rééducation.
- 2 - Analyse générale
La répartition des patients n'est pas homogène en ce qui concerne leur devenir professionnel envisagé après la rééducation. Deux variables le mettent en évidence.
La répartition des sexes est modifiée. Alors que les hommes sont largement majoritaires (60%) dans l'ensemble de notre échantillon, ils sont beaucoup plus fréquemment en activité (66% des personnes en activité) avant l'atteinte visuelle ou le début de prise en charge que les femmes. A l'inverse, parmi l'ensemble des personnes qui envisagent de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle ou de formation après la rééducation, la part des femmes croît très significativement passant à 40%, alors qu'elle n'était que de 34% des personnes initialement en activité.
 Tableau 1
Tableau 1
Facteurs sexe et âge dans le devenir professionnel
De même, en ce qui concerne l'âge moyen alors que celui de l'ensemble de la population est autour de 38 ans, on remarque que l'âge moyen des personnes qui envisagent de reprendre une activité est lui en moyenne inférieur de 6 ans.
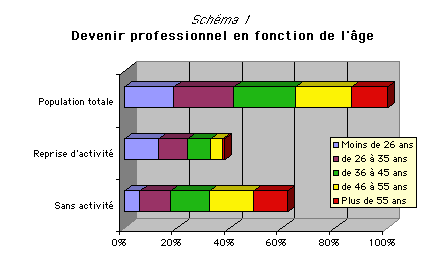
Le schéma 1 permet de détailler cette observation. En effet, parmi ceux qui envisagent de reprendre une activité on constate :
- une sur-représentation des personnes de moins de 35 ans,
- un nombre proportionnellement identique à l'ensemble de la population, des 36/45 ans,
- une régression très forte de la part des 46/55 ans et une totale disparition du monde du travail des plus de 55 ans.
On constate (tableau 2), que si 586 sujets, soit 68,5% de la population totale, avaient une activité professionnelle ou une formation en cours avant le handicap ou la rééducation, cette situation n'est envisagée que pour 356 personnes après rééducation, c'est-à-dire 60,7% de la population initialement en activité.
Plusieurs remarques sont utiles, pour nuancer ces résultats :
- Cette poursuite d'activité suppose un investissement en formation important. Initialement, 13% des actifs étaient en formation générale ou professionnelle, alors que ce doit être le cas de 53% d'entre eux après rééducation. Toutefois, dans un grand nombre de cas (28%), ces formations ne sont pas immédiatement qualifiantes, mais vont permettre à chacun de préciser son choix professionnel ou plus modestement, de poursuivre l'effort d'adaptation à la déficience et aux outils utiles pour la compenser (informatique, Braille, systèmes optiques, etc.) Il s'agit alors d'année « préparatoire », de périodes de « préformation » ou de stages plus spécifiquement ciblés en fonction d'un type de problématique ou de pathologie, comme par exemple les stages de retour à l'emploi organisés dans les UEROS (Unités d'Evaluation, de Réentraînement et d'Orientation Sociale et/ou professionnelle pour Traumatisés Crâniens). On ne peut donc pas, dans tous les cas, parler d'une démarche de retour à l'emploi mais plus, pour certains, d'un prolongement logique du travail de réadaptation effectué durant leur séjour de rééducation dans l'établissement.
- Parmi les différentes catégories de professions, le taux de reprise d'activité, éventuellement avec un aménagement de poste, est très variable (Cf. Tableau 3). C'est tout particulièrement sensible pour les emplois d'ouvriers. Alors qu'ils étaient 152, ils ne sont plus que 8 prévus en fin de rééducation, soit une diminution de 95%. La situation des artisans, des commerçants et des agriculteurs est, elle aussi, difficile dans la mesure où peu d'entre eux pensent être en mesure de poursuivre leur activité (29%). Il est à noter que plusieurs agriculteurs ou agricultrices vont garder le même statut professionnel alors qu'en fait, ils ou elles envisagent une réduction importante de leur rôle dans l'exploitation. En revanche la situation des employés (correspondant à des fonctions du tertiaire de niveau CAP/BEP ou inférieur) et des techniciens (correspondant à des fonctions de maîtrise et/ou de niveau Bac ou Bac plus 2) est proportionnellement meilleure. En effet, la diminution du nombre d'employés n'est que de 64% et celle du nombre de techniciens de 59%.
- Le cas des cadres et des professions libérales est lui contrasté, dans la mesure où si la diminution moyenne est importante (de l'ordre de 70%), elle concerne en fait davantage les professions libérales et les indépendants. Les cadres conservent, proportionnellement, plus aisément leur activité.
- La même variabilité s'observe au niveau des formations ; les formations générales ou supérieures régressent (respectivement de 64% et 41%), au profit des formations professionnelles, dont le nombre s'accroît de 93%.
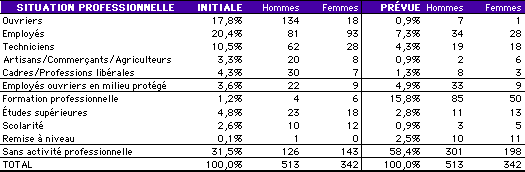
Tableau 2
Evolution des situations professionnelles
- 3 - Les orientations choisies
Les sujets qui poursuivent une activité professionnelle le font pour la plupart dans la même entreprise, ou dans le même cadre libéral, mais avec une définition de poste généralement différente. Cette modification de poste de travail n'est, pour notre population, généralement pas accompagnée d'un changement de qualification (le technicien reste technicien, l'employé reste employé), à l'exception des ouvriers qui semblent plus facilement reclassés dans des emplois de bureau que dans des activités manuelles. Il n'a pas été observé de cas où une déqualification importante est prévue après rééducation (Cf. tableau 4).
Les aménagements de poste quand ils sont possibles, le sont souvent grâce au recours, en totalité ou pour partie, à du matériel informatique adapté pour déficients visuels ; synthèse vocale, système de grossissement des caractères affichés à l'écran, plage de braille éphémère, notamment. Ce type d'adaptation explique donc, pour partie, le meilleur taux de reconversion vers les emplois de bureau que vers les professions manuelles ou nécessitant l'utilisation de machines ou de technologies pointues (et donc peu adaptables à la déficience visuelle).
Parmi les formations professionnelles envisagées après rééducation, on remarque la faible proportion des formations manuelles de bas niveau, horticoles, artisanales ou du bâtiment (0,3% des cas), et la domination croissante des formations informatiques ; programmation, technicien, (17%), et tout particulièrement de celles orientant vers le secrétariat, l'accueil et le standard, regroupées depuis peu sous l'intitulé : AAC : Agent d'accueil et de communication (33%). Évolution qui s'explique par la multiplication des matériels et des formations informatiques adaptées aux déficients visuels, alors qu'il y a peu de formations et de débouchés en milieu ordinaire offerts par les activités manuelles peu, ou pas, qualifiées.
Il est à noter cependant que l'évolution des offres de formations professionnelles spécialisées s'adressant aux personnes déficientes visuelles détermine aussi pour partie ces résultats, dans la mesure où :
- les formations manuelles ou peu qualifiées sont rares (ou, pour certaines d'entre elles, ne sont plus accessibles qu'aux personnes atteintes d'une malvoyance légère),
- le nombre de postes offerts en formation et la diversité des établissements spécialisés pour déficients visuels proposant des formations informatiques de niveau de technicien est plus réduit,
- La formation d'AAC reste la seule accessible à des personnes peu qualifiées souhaitant s'orienter vers des emplois de bureaux.
Les orientations vers les formations autrefois classiques pour déficients visuels sont :
- soit en très légère régression au cours des années étudiées pour la kinésithérapie (18% des orientations de formation de 1987 à 1992 alors qu'elles ne représentent plus que 11% pour l'ensemble des 855 patients hospitalisés jusqu'en 2002),
- soit en légère augmentation pour le standard, qui représentent au total 1/3 des nouvelles orientations choisies, même si, comme nous l'évoquions plus haut, cette orientation est fréquemment choisie, par défaut ou dans le désir de poursuivre la démarche de réadaptation entreprise et donc sans visée qualifiante ou professionnalisante,
- et en forte régression en ce qui concerne les orientations vers des métiers manuels dans le milieu ordinaire.
Enfin, les orientations vers les postes du milieu protégé, (postes en CAT ou en ateliers protégés) restent des opportunités fréquemment choisies (dans près de 5% des cas pour l'ensemble de notre population). 26% des sujets choisissant cette orientation étaient jusqu'alors en milieu ordinaire (dans des postes manuels peu qualifiés pour la plupart), en formation ou sans activité (Cf. Tableau 4).
- 4 - Evolution sur 13 ans du devenir professionnel
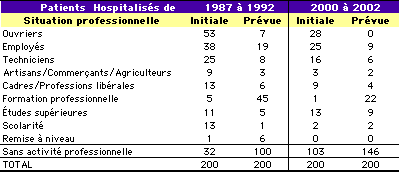 Tableau 3
Tableau 3
Evolution sur 13 ans du devenir professionnel à partir de deux cohortes de 200 patients
L'étude de deux cohortes de patients séparées par un écart de 13 ans, met en évidence :
- la disparition des maintiens dans l'emploi des postes d'ouvriers comme celui des formations ou prés-formations de bas niveaux (regroupées ici sous l'intitulé de remise à niveau),
- la plus grande fréquence des poursuites des formations scolaires ou supérieures
- et globalement une diminution significative du taux de poursuite ou de reprise d'activité qui passe de 50% à 36%.
Cette baisse est à relier d'une part à l'aggravation de la conjoncture en ce qui concerne le marché du travail ces 13/15 dernières années, mais aussi à une modification sensible de la population des patients admis en hospitalisation. Ces derniers sont en effet, souvent plus âgés, atteints d'une déficience visuelle en moyenne plus sévère et ancienne mais aussi plus fréquemment compliquée d'une ou de plusieurs autres déficiences. Les résultats de l'ensemble de notre échantillon de 855 sujets (qui recouvre presque totalement ces deux périodes) donnent en effet des chiffres moyens, moins bon que ceux de la cohorte de 1987 à 1992 mais meilleurs que les chiffres les plus récents de 2000 à 2002. La diminution du taux de poursuite ou de reprise d'activité a donc valeur de tendance générale pour notre population.
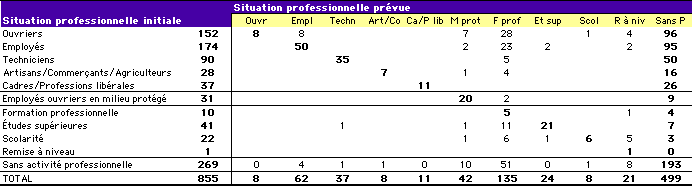 Tableau 4
Tableau 4
Evolution des situations professionnelles en fonction du type d'activité initiale
Si l'on croise le niveau de formation et le devenir professionnel envisagé par les patients à la fin de leur prise en charge (Tableau 5), on constate que :
 Tableau 5
Tableau 5
Niveau de formation et devenir professionnel
- le niveau d'étude est un facteur favorisant l'accès à la reconversion professionnelle par le biais de la poursuite ou de la reprise d'une formation après la rééducation, sauf pour les niveaux initiaux de formation supérieurs à BAC plus 2,
- qu'il n'est pas en revanche corrélé avec une reprise d'activité professionnelle sauf, là encore, pour les niveaux initiaux de formation supérieurs à BAC plus 2. Le taux moyen de reprise d'activité est le même pour les sujets ayant un CAP que pour ceux ayant un BAC ou un BAC plus deux.
Ce qui met en évidence que, malgré les adaptations informatiques et optiques bien adaptées aux emplois de bureau, le marché de l'emploi est plus tendu pour les personnes déficientes visuelles, notamment si elles n'ont pas atteint le niveau licence ou équivalent. Ce qui s'observe par exemple par la difficulté pour elles d'être admises à des emplois dans la fonction publique après concours administratifs. Ce n'est pas que leurs compétences professionnelles ou leur adaptation fonctionnelle aient changé c'est que le niveau moyen des candidats handicapés ou non, (et par-là, celui des admis) a lui fortement augmenté.
- 5 - Devenir professionnel en fonction de la déficience visuelle
La plupart des personnes qui envisagent de reprendre une activité professionnelle après la rééducation ont une déficience visuelle liée à une atteinte de l'oeil ou de ses annexes d'origine non traumatique (maladies dégénératives de la rétine, infection de la cornée, opacification des milieux transparents, etc.) A l'inverse, les patients pour qui l'atteinte visuelle est d'origine traumatique et/ou liée à une lésion cérébrale sont peu nombreux à prévoir une reprise d'activité (schéma 2). En effet, pour ces derniers, comme dans une moindre mesure pour les patients ayant une déficience visuelle suite à une intoxication ou à une maladie générale, la déficience est en moyenne plus grave (le potentiel visuel absent ou très réduit) et plus fréquemment associée à d'autres troubles ou déficiences qui modifient complètement le tableau clinique, aggravant d'autant les possibilités de réadaptation professionnelle.
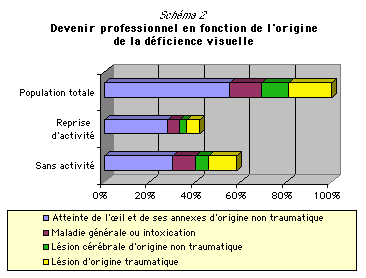 De même, on constate que les patients pour qui la déficience visuelle est acquise au cours de la vie ont un pronostic de reprise d'activité significativement plus faible, au vu de notre population (schéma 5) que dans les cas où la déficience est congénitale ou acquise avec une participation héréditaire. Dans ces cas, le taux de prévision de reprise d'activité est meilleur. La sur-représentation des patients ayant une pathologie congénitale parmi ceux qui pensent reprendre une activité est la plus marquée (un sur deux pense retravailler ou suivre une formation). En effet, ces patients entreprennent une rééducation au cours de leur vie alors qu'ils sont déjà, pour nombre d'entre eux, en situation professionnelle ou en cours d'études. La rééducation n'est dans la perspective professionnelle qu'un atout supplémentaire ou un moyen de rebond et d'adaptation ou de diversification de l'activité. De plus, dans un grand nombre de cas, et principalement pour les patients porteurs d'une déficience visuelle acquise avec une participation héréditaire, l'aggravation de la déficience se produit de manière progressive étalée, uniformément ou par poussées, au long de la vie ou du début de la vie d'adulte.
Cela suppose que :
De même, on constate que les patients pour qui la déficience visuelle est acquise au cours de la vie ont un pronostic de reprise d'activité significativement plus faible, au vu de notre population (schéma 5) que dans les cas où la déficience est congénitale ou acquise avec une participation héréditaire. Dans ces cas, le taux de prévision de reprise d'activité est meilleur. La sur-représentation des patients ayant une pathologie congénitale parmi ceux qui pensent reprendre une activité est la plus marquée (un sur deux pense retravailler ou suivre une formation). En effet, ces patients entreprennent une rééducation au cours de leur vie alors qu'ils sont déjà, pour nombre d'entre eux, en situation professionnelle ou en cours d'études. La rééducation n'est dans la perspective professionnelle qu'un atout supplémentaire ou un moyen de rebond et d'adaptation ou de diversification de l'activité. De plus, dans un grand nombre de cas, et principalement pour les patients porteurs d'une déficience visuelle acquise avec une participation héréditaire, l'aggravation de la déficience se produit de manière progressive étalée, uniformément ou par poussées, au long de la vie ou du début de la vie d'adulte.
Cela suppose que :
- les orientations professionnelles peuvent donc dans certains cas intégrer une déficience visuelle présente et éventuellement évolutive,
- l'adaptation fonctionnelle des patients constatant une baisse progressive de leur vision est généralement très significativement meilleure que celle des patients dont la déficience visuelle est apparue de manière brutale. Or, une majorité de patients qui sont porteurs d'une déficience visuelle acquise, ont eu une baisse de leur vision d'emblée ou très brutale, dans les situations de traumatismes par exemple.
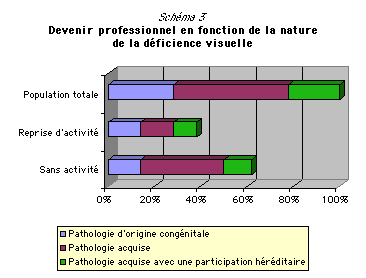
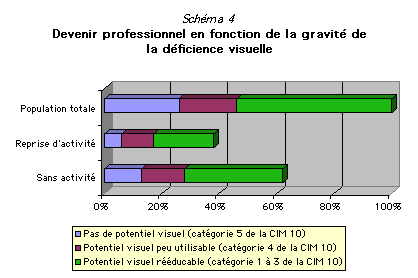
Enfin, l'étude de l'ensemble de notre population montre que les déficiences visuelles suite à un traumatisme ou à une lésion cérébrale, sont fréquemment accompagnées de déficiences associées et d'une plus grande gravité de l'atteinte visuelle (plus grand nombre de cécité complète notamment). Ces deux facteurs s'opposent à une reprise d'activité et tout particulièrement à ce que la reprise d'activité soit envisagée dès la fin de la rééducation fonctionnelle dans l'établissement.
On observe en effet (Schéma 4), un pronostic de reprise de travail ou de formation mauvais pour les personnes totalement aveugles. Ces dernières sont sous-représentées parmi celles qui envisagent de reprendre une activité. Pour les malvoyants en revanche, leur proportion est à peu près constante, qu'ils pensent ou non reprendre un travail ou une formation. Là encore il est probable que la fréquente association de la cécité avec une atteinte visuelle brutale de type accidentel et compliquée d'autres déficiences, abaisse très nettement le pronostic moyen de reprise d'activité des non voyants.
- 6 - Devenir professionnel et évaluation quantitative de
la nature et de l'effet de la rééducation proposée
L'évaluation des résultats de la rééducation fonctionnelle repose sur la quantification du nombre de séances de rééducation proposées par domaine et par patient (tableau 10) et l'analyse quantitative des échelles d'évaluations d'autonomie (Tableau 6). Ces échelles ont pour but de permettre de chiffrer l'autonomie des sujets au moment de leur entrée en rééducation, l'autonomie obtenue en fin de prise en charge et l'évolution de l'autonomie durant la prise en charge tant en ce qui concerne la maîtrise des moyens de communication écrite (écriture manuscrite, informatique et braille), les moyens de déplacement, l'efficience dans l'utilisation du potentiel visuel et l'autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (AVQ). Il est important de savoir que l'intitulé informatique peut recouvrir, selon les patients et leur période d'hospitalisation, à la fois la maîtrise de l'outil lui-même, des éventuelles adaptations nécessaires à sa mise en oeuvre (synthèse vocale, plage tactile Braille, système de grossissement etc.), des applications bureautiques classiques et l'usage du réseau Internet (navigation et messagerie pour le moins).
Il est important de noter que ce qui est évalué est l'autonomie, c'est-à-dire la capacité dont dispose le sujet de parvenir à l'organisation et la réalisation des tâches considérées. Mais cette autonomie n'est pas nécessairement une indépendance. En effet, il se peut que le sujet ait besoin de façon ponctuelle ou régulière de faire appel à l'assistance de tiers pour parvenir à son but. Ainsi, un patient considéré comme totalement autonome pour se déplacer en centre ville, peut très bien avoir recours systématiquement à une aide demandée à des tiers (des passants par exemple) pour franchir un certain type de voies de circulation (comme des avenues quatre voies, à fort trafic, et ne disposant pas de terre-plein central ni de feu tricolore). Il est, selon notre échelle, considéré comme autonome alors qu'il ne dispose pas de l'indépendance lui permettant d'effectuer seul cette activité.
Les résultats correspondent au niveau d'autonomie moyen obtenu dans chacun des 6 domaines de rééducation par l'ensemble du groupe de patients concerné. La population de référence pour cette étude est plus réduite que celle initialement considérée. Ainsi l'évaluation du niveau d'autonomie à l'entrée est calculée à partir des 472 derniers patients hospitalisés (soit hospitalisés entre le 1/01/96 et le 1/10/02). De même, l'évaluation du nombre de séances de rééducation est calculé à partir des 585 derniers patients hospitalisés (soit hospitalisés entre le 1/10/93 et le 1/10/02). Seule l'évaluation de l'autonomie en fin de rééducation, s'appuie sur les résultats des 855 personnes composant la population de cette étude. Aussi, les résultats ne peuvent pas correspondre exactement terme à termes du fait de la disparité des échantillons et du mode de calcul (une moyenne de progression est différente de la moyenne de l'autonomie obtenue diminuée de celle observée à l'entrée, par exemple).
 Tableau 6
Tableau 6
Echelles d'évaluation de l'autonomie
On remarque que les personnes qui envisagent de prendre ou de reprendre une activité à l'issue de cette prise en charge ont un niveau moyen d'autonomie plus élevé que celles qui pensent rester inactives. Mais le différentiel est beaucoup plus significatif en ce qui concerne le niveau de maîtrise de l'informatique. L'efficience en ce domaine est étroitement corrélée à la reprise d'activité (4,42 de niveau moyen d'autonomie obtenu pour un nombre de séances égal à celui de la moyenne des patients, alors que le niveau moyen d'autonomie est de 3,18 pour l'ensemble de la population et de 2,41 pour ceux qui n'envisagent pas de reprise d'activité).

Tableau 7
Autonomie observée en début de rééducation
La part de l'informatique dans la reprise d'activité remplace celle occupée par le Braille dans notre étude précédente (menée à partir de 200 patients hospitalisés entre le 1/10/87 et le 17/09/93). Ce dernier reste généralement mieux maîtrisé par ceux qui vont reprendre une activité mais de façon beaucoup moins marquée, que de l'informatique.
La bonne maîtrise des déplacements est évidemment un facteur important et les résultats obtenus par ceux qui vont reprendre une activité sont bons, mais sans que cela ait une valeur prédictive dans la mesure où le gain d'autonomie est égal au gain moyen de l'ensemble de la population (tableau 9). Il faut souligner que le niveau moyen en informatique en fin de rééducation est meilleur chez les femmes, celles-ci reprenant le travail dans des proportions légèrement plus importantes que ne le font les hommes.
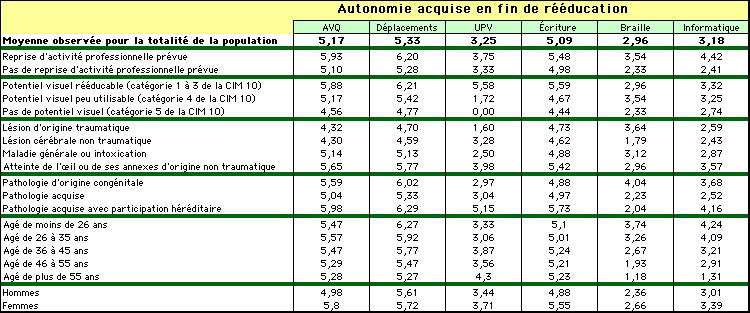
Tableau 8
Autonomie observée en fin de rééducation
Il est à noter que le niveau moyen d'autonomie en fin de rééducation des femmes est meilleur que celui des hommes dans les 6 domaines étudiés, de même que l'est leur gain moyen d'autonomie (à l'exception du Braille pour lequel, à la différence des autres domaines, elles ont un nombre moyen de séance de rééducation un peu plus faible que celui des hommes). A l'entrée là aussi, leur niveau moyen est légèrement supérieur, hormis en ce qui concerne les déplacements.
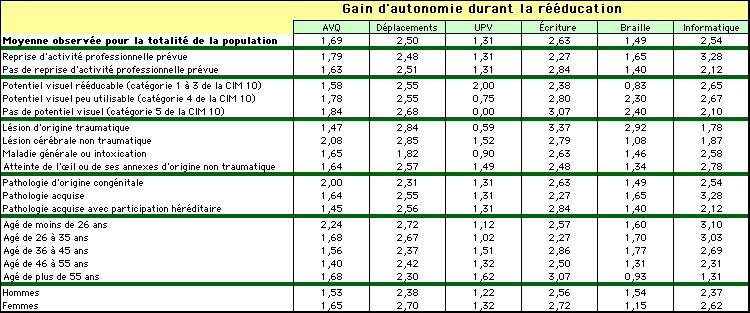
Tableau 9
Gain d'autonomie durant la rééducation
On observe un gradient d'autonomie proportionnel à la quantité de potentiel visuel conservé. Ainsi, dans les 5 domaines concernés, les patients qui n'ont pas de vision (catégorie 5 de la CIM 10) obtiennent le niveau d'autonomie le plus faible. Une explication possible de cette observation est la grande diversité de cette population. Les patients non voyants congénitaux ont généralement un niveau d'autonomie relativement bon ou pour le moins proche de la moyenne, mais parmi les non voyants, on observe nombre de sujets dont la cécité est brutale, d'origine accidentelle et compliquée d'autres déficiences. Ces derniers obtiennent eux des résultats en terme d'autonomie beaucoup moins bons. Alors qu'ils nécessitent une prise en charge en moyenne plus longue et un nombre de séances beaucoup plus élevé, tout particulièrement en ce qui concerne les déplacements et les AVQ.
 Tableau 10
Tableau 10
Nombre de séances de rééducation réalisées durant la prise en charge
L'origine de la déficience visuelle a une incidence sur les résultats dans la mesure où les personnes porteuses d'une atteinte de l'oeil ou de ses annexes d'origine non traumatique, obtiennent le meilleur niveau d'autonomie en fin de rééducation. Il s'agit pour la plupart de patients malvoyants (catégorie de 1 à 3 de la CIM 10) et pour un grand nombre de sujets dont la pathologie est acquise avec une participation héréditaire (comme les rétinopathies pigmentaires). Nous avons déjà montré par ailleurs (schéma 2), que cette catégorie de patients a le meilleur pronostic de poursuite ou de reprise d'activité professionnelle après rééducation.
La forte proportion de non-voyants parmi les patients atteints de déficience visuelle d'origine traumatique s'observe par le niveau faible d'autonomie de cette population en UPV et le relativement bon niveau moyen en Braille. En revanche, pour les atteintes visuelles suite à une lésion cérébrale d'origine non traumatique, on observe un très faible niveau de Braille et une meilleure efficacité dans l'utilisation du potentiel visuel. En effet, nombre de ces sujets présentent des troubles neuro-visuels ou neuro-psychologiques diffus, c'est-à-dire difficilement évaluables à partir de nos échelles d'évaluation de l'autonomie (Tableau 6). Pour certains même, alors que la déficience visuelle est considérée à l'entrée comme la cause majeure des désadaptations observées, on constate au cours de la prise en charge, sa très faible importance (acuité normale et champ visuel faiblement altéré, quand il est possible de les évaluer) au vu des troubles neuro-psychologiques (d'auto activation, de mémoire, de suivie de l'attention, de désorientation temporo-spatiale, etc.) ou neuro-moteurs (syndrome cérébelleux, par exemple).
L'observation de la variable de l'âge des patients permet de mettre en évidence un certain nombre de traits. On constate que ce sont les personnes les plus âgées qui obtiennent de meilleurs résultats en UPV, de même qu'elles avaient à l'entrée la plus grande efficience dans l'utilisation de leur potentiel visuel. On avait effectivement constaté, lors d'une précédente étude, que le gain en terme de qualité de vie, de tonicité et d'indépendance n'était pas corrélé à l'évolution quantitative de l'autonomie évaluée par nos échelles. Ou, pour être plus précis, qu'une faible progression de l'autonomie produisait chez les personnes âgées et très âgées d'importants changements dans leur vie, en terme d'efficience fonctionnelle et d'évolution psychologique (confiance en soi, élan vital, resocialisation etc.)
En revanche, en Braille et en informatique, l'âge est un facteur défavorisant, selon un gradient continu. Pour les patients les plus jeunes (tranche d'âge comprise entre 16 et 26 ans dans notre population) on observe des résultats en fin de rééducation très significativement au-dessus de la moyenne en déplacement, informatique et AVQ. Ces bons résultats sont accompagnés par une augmentation du nombre moyen de séances proposées dans ces trois matières sans que l'on puisse mettre en évidence un allongement de la durée de rééducation. Ils progressent plus vite et bénéficient de davantage de séances sur une durée totale semblable à la moyenne.
L'analyse de ces 855 personnes ayant effectué une rééducation dans notre établissement permet de tracer à grand trait, la situation et l'évolution du devenir professionnel des déficients visuels.
On constate que la situation de l'emploi ou du retour à l'emploi des personnes déficientes visuelles est de plus en plus complexe, avec un taux de retour à l'emploi en régression sur les 15 années couvertes par cette étude. Toutefois deux facteurs permettent de nuancer ces données.
- D'une part, la population hospitalisée a, elle aussi, nettement changé durant cette période. Notre prise en charge s'est adaptée à des cas de plus en plus complexes, des déficiences visuelles plus anciennes, plus fréquemment associées à d'autres déficiences compliquant d'autant le travail de réadaptation. Si le retour à l'emploi est plus complexe, le tableau clinique des patients hospitalisé est lui souvent plus lourd.
- D'autre part nombre de patients cherchent à rester ou à entrer dans le monde du travail par le biais du recours à des formations professionnelles, le plus souvent spécialisées. Mais pour beaucoup d'entre eux, le niveau des formations proposées est trop élevé et ils se voient contraints de se rabattre sur des formations d'attente, type AAC (Agent d'accueil et de communication) qui sont de ce fait fortement demandées alors qu'elles restent relativement peu pourvoyeuses d'emploi.
- Parmi l'ensemble des formations professionnelles, on constate que l'importance des formations et orientations historiquement proposées se réduit, très significativement pour les formations manuelles, plus faiblement pour celles de Kinésithérapeutes et d'employés de bureau au niveau technicien.
Dans la plupart des cas, la réorientation tient compte des compétences et de l'expérience professionnelle acquise par les sujets. Toutefois cette réorientation est d'autant plus difficile que le niveau initial de qualification est bas et que l'activité pratiquée est manuelle.
Pour notre échantillon, on observe que la gravité de la déficience visuelle, son association à d'autres déficiences et/ou le fait qu'elle soit survenue de manière traumatique sont autant de facteurs limitant tant la portée fonctionnelle de la rééducation que la réadaptation professionnelle. Enfin, le niveau de maîtrise de l'informatique est fortement corrélé avec une reprise d'activité professionnelle ou de formation.
Sources : GRIFFON, P. Déficiences visuelles. Édition du CTNERHI Paris 1995 (avec l'autorisation de l'éditeur).
Etude statistique, réalisée en collabotration avec M. GUIMPIED (Assistante Sociale)
en décembre 2002 (dernière mise à jour
le 22/09/10)
Pour en savoir plus sur l'insertion professionnelle des adultes déficients visuels
- Accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Guide méthodologique. Ministère de l'emploi et de la solidarité. 2001
- ADECCO , L’emploi des personnes handicapées en Europe. Quel présent pour quel avenir ? observatoire des hommes et des organisations, 2001
- Adultes Handicapées. Formation professionnelle / Etablissements. ONISEP service réadaptation 1998
- AKIKI, B. Rôle des expectations dans la motivation au travail chez les adultes déficients visuels en formation professionnelle spécialisée. Thèse de doctorat en psychologie, Université de Nanterre 1995
- ALLOUCHE, J., PARIAT, M. Guide de l'insertion professionnelle et sociale. Dunod 1997
- AMAR, M., AMIRA, S. Incapacités, reconnaissance administrative du handicap et accès à l'emploi : les apports de HID. Revue Française des Affaires Sociales, 2003, n° 1-2
- AMAR, M., SELMA, A. Quel accès à l'emploi en milieu ordinaire pour les travailleurs handicapés ? Communication au colloque "Premiers travaux d'exploitation de l'enquète HID", DREES, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 2001, Série études n°16, 7-16
- AMIRA, S., OKBA, M., RAMARE, A. Les travailleurs handicapés en 2000: des embauches en augmentation grâce à une bonne tenue de l'emploi. Premières informations et premières synthèses. DARES, 2002, n° 47.1
- BAPTISTE, R. Reconnaître le handicap psychique. Développer et améliorer la réinsertion sociale et professionnelle des personnes psychiquement fragiles. Lyon : Chronique sociale ; 2005. Jaeger, M. L’articulation du sanitaire et du social : travail social et psychiatrie Paris : Dunod ; 2000.
- BARRAL, C., CHAUVIERE, M., STIKER, H-J. A-t-on renoncé à inclure ? Retour sur les lois de 1975 et leurs suites. Esprit 1999, n° 259
- BAUDET-CAILLE, V. L'insertion par l'activité économique. Editions ASH 2000 supplément au n° 2193
- BEN LOULOU, G., ROUFF, K., BARGANEL, L., et al. La réinsertion professionnelle des handicapés psychiques. Lien Social 2004 ; (725) : 4-16.
- BLAIZE, J.L., DE LABARTHE, J. Stage ergothérapique en entreprise : un outil spécifique dans la réadaptation du traumatisé crânien. Expérience en ergothérapie Masson; 1991, ; troisième série; pp 71-84
- BLANC, A. Les handicapés au travail : analyse sociologique d'un dispositif d'insertion professionnelle. Dunod 1995
- Blanc, A. Stiker, H-J. L’insertion des personnes handicapées en France. Bilan et avenir d’un demi-siècle d’expérience. Desclée de Brouwer, 1998
- BLANC, A., STIKER, H.J. L'insertion professionnelle des personnes handicapées en france. Desclée de Brouwer 1998
- BOISSONNAT, J. Le travail dans vingt ans. Rapport au Commissariat général au plan. Odile Jacob 1995
- BONNEFOND, G. De l'institution à l'insertion professionnelle : le difficile parcours des jeunes déficients intellectuels. Ramonville Saint-Agne : Erès, 2006, 285p
- BORDONE, J. Guide des politiques locales d'insertion. Dunod 1999
- BOULARD, P., DEFRASNE-GUERQUIN, M.O., HOLZSCHUCH, C. Maintien au poste de travail des personnes devenues handicapées visuelles. Journal d'ergothérapie 1998, 20, 3, 104-107
- BOURLIER, F. La réinsertion socio-professionnelle des non-voyants récents : un parcours difficile. Paris : AP-HP, Mémoire pour le D.E. d'assistant de service social, 1992, 56p
- BOUSSAÏD, L. Etude comparative de la situation des non-voyants en Europe : éducation, formation, emploi. in : L'intégration des personnes handicapées : quelques éléments de bilan. Revue française des affa ires sociales, 1998/03, n°1, 143-150
- BURGER, D. Accessibilité du poste de travail informatique pour les personnes handicapées de la vue : état de la question, nouvelles perspectives. In : FARDEAU, M., RAVEAU, J.F. Insertion sociale des personnes handicapées : méthodologie d'évaluation. INSERM 1994, 16, 165-181
- CAUSSE, L., FOURNIER, C., LABRUYERE, C. Les aides à domicile. Des emplois en plein remue-ménage. Syros 1998
- CFDT Les handicapés au travail : intégrés mais pas égaux... Le Travail en questions, novembre 2000, 1-18.
- CHAIB, M. La politique suédoise d'intégration des personnes handicapées en question. Handicap et inadaptation, les cahiers du CTNERHI, 1997, n° 74, 1-14
- CHAIX M. La politique de l'emploi des personnes handicapées. Revue française des affaires sociales. 1998, 52, 1/1998
- CHANUT, J.M. L'activité des COTOREP en 2002. Etudes et résultats n° 267, DREES, 2003
- CHANUT, J.M., PAVIOT, J. L'activité des COTOREP en 2000. Document de travail n° 32, DREES, 2002
- CHANUT, J.M., PAVIOT, J. L'activité des COTOREP en 2001. Document de travail n° 42, DREES, 2002
- CHARPENTIER, F. L'embauche des personnes handicapées devrait faire l'objet de négociations. La tribune de l'expansion 29 juin 1992
- CHAVEL, T. Le coaching démystifié. Demos 2002
- CHAZAL, P. Les aveugles au travail. Le Cherche Midi 1999
- CHAZAL, P. Les spécificités de l'emploi des personnes aveugles ou atteintes de déficience visuelle profonde. Bulletin confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, 2009, no 16
- CHEVALERAUD, J., FOELS, A., CORBE, C., BOISSIN, J.P. Des inaptitudes professionnelles au handicap visuel. Bulletin des Sociétés d'Ophtalmologie de France. 1993, 93, 363-444
- Conseil de l’Europe, Stratégies dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées : le rôle des employeurs. Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 1995
- Coordination et cohérence des politiques d'emploi et de formation professionnelle en faveur de l'intégration économique des personnes handicapées au niveau européen. Rapport de la conférence de Bruxelles 1990 Programme HELIOS. 79 Av de Cortenberg B 1040 Bruxelles
- CORDEY, V. Les décisions des COTOREP concernant l'allocation aux adultes handicapés en 1999. DRESS 2000
- COSANDEY, R. L'insertion professionnelle des aveugles : histoire, perspectives, recommandations. In P. Chazal (Bd.). Les aveugles au travail. Paris : Les cherche midi éditeur, 1999, 39-41
- DARES L'Emploi des personnes handicapées. Rapport sur l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés en 1997. Politique de l'emploi en 1997 et 1998, Paris, DARES, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, ministère de l'Emploi et de la Solidarité. 1999.
- DORIGUZZI, P. L'histoire politique du handicap : de l'infirme au travailleur handicapé. Paris : L'harmattan, 1994, 223p
- DU GARREAU, R. Le télé-enseignement au service des personnes handicapées. Réadptation 1998, 454, 23-25
- EUDELINE, Y. Mettre en oeuvre une politique locale d'insertion pour accompagner les personnes en difficultés vers l'emploi. CAFDES, ENSP 2001
- EVANS, P., LABON, D. L'insertion scolaire des handicapés. OCDE-CERI, 1999
- Fardeau, M. Comme vous, comme nous, tout simplement. analyse comparative et prospective du système français de prise en charge des personnes handicapées. établi avec la collaboration de Sabine Avril, Christine Bon, Bachir Kerroumi et Geneviève Lang, rapport au Ministre de l’emploi et de la solidarité et au secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, CNAM, septembre 2000
- FARDEAU, M., DIETRICH-SAINSAULIEU, C., LE VAILLANT, M. Les décisions d'orientation par les COTOREP des personnes handicapées en 1988. Solidarité santé - Etudes statistiques, 1991, 1, 25-38
- FARDEAU; M. Analyse comparative et prospective du système français de prise en charge des personnes handicap&eacu te;es. Rapport au Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. 2000, 234 p
- FONTIER, R. handicap et fonction publique. Guide pratique pour l'emploi et la carrière des travailleurs handicapés. CTNERHI 2003
- Formation professionnelle des personnes handicapées. CTNERHI, dossier professionnel n° 4 1999
- GAULLIER, X. Les temps de la vie. Emploi et retraite. Editions Esprit 1999
- GENDRON, B. Handicap et emploi: un pari pour l'entreprise. C.T.N.E.R.H.I. 1994
- GENDRON, B. Le comportement d'offre de travail des déficients visuels : tentatives d'explications à partir d'une enquête. Handicap - revue de sciences humaines et sociales, 2002, n° 96, 2146
- GERBE BAILLY, L., NEGRE, M. L'emploi des personnes handicapées en milieu protégé, en France : le coût pour l'Etat. in : Revue européenne du handicap mental, 2001/01, n°22, 17-39
- GOMEZ, G. Le handicap est-il un handicap à l'emploi? La loi de 1987. Réadaptation 1992 391, 20-22
- GOUARNE, R., BOE, F., CHAZAL, P., DUPUY, J., GENDRON, B. Les aveugles dans l'entreprise : Quelles perspectives ? L'Harmattan. 1997
- GRIFFON, P. Basses visions : prise en charge, nouvelles orientations. Actes des XXièmes journées de l'ALFPHV Paris 1990
- GRIFFON, P. Déficiences visuelles : pour une meilleure intégration. C.T.N.E.R.H.I. 1995
- GRIFFON, P. Devenir malvoyant à l'âge adulte. Inforum N° 3/96, 32-35 Zurich 1996
- GRIFFON, P. Etude de 82 malvoyants pris en charge au centre de rééducation de Marly-le-Roi. L'accès à la lecture. CRFAM Marly-le-Roi 1991
- GRIFFON, P. Internet : Ein Ort ohne Unterschiede. Über die Vorteile des Netzes für die Integration Behinderter. Schweiz. Verein des Fachkräfte für Körper- und Mehrfachbehinderte. Bulletin 1998, 27-31
- GRIFFON, P. Internet, un moyen de lutter contre l'exclusion. Communication au colloque INSERM "Les outils télématiques dans l'éducation des Handicapés Visuels" Paris 1998
- GRIFFON, P. La rééducation des malvoyants. Privat 1993
- GRIFFON, P. La rééducation fonctionnelle des adultes atteint de rétinopathie pigmentaire. Communication au colloque de l'A.F.R.P. Paris 1994
- GRIFFON, P. Les nouvelles technologies et leurs applications dans la rééducation et l'insertion des déficients visuels. Communication au colloque &quo t;Handicap et nouvelles technologies" Athènes 1991
- GRIFFON, P. L'information à la porté de tous ? Intégration des personnes handicapées et Internet. INFORUM Zürich 1997 4/97, 12-15
- GRIFFON, P. L'ordinateur au service de la lecture des malvoyants. Communication aux journées de l'AFRP Ile de France, Paris 1997
- GRIFFON, P. Rééducation fonctionnelle : vers une plus grande autonomie. Journal des psychologues 1991 84, 24-25
- GRIFFON, P., DUTIER, N., PERROT, F., GUILLAUME, C., BURLOT, C. La rééducation des personnes déficientes visuelles. Evolution des pratiques en ergothérapie. Journal d'ergothérapie 1992 14, 2, 50-54
- Guide du jeune et de l'enfant. Edition ASH 2000
- Guide Européen de bonnes pratiques pour l'égalité des chances des personnes handicapées. Helios II, Commission européenne DG V/E3. Office des publications officielles des communautés européennes L-2985 Luxembourg
- Guide pour l'emploi des Handicapés. Etre et Connaître. 1995
- Guide pour les personnes handicapées. Néret 2003
- GUITEAU, F. Le pôle déficience sensorielle de la Mutualité Française Anjou Mayenne. Réadaptation, 2004, n°510, 26-28
- Handicap et travail : quel avenir pour les personnes handicapées ? APF formation Actes du colloque de l'UNESCO Janvier 1997
- Handicapés et emploi : une difficile comparaison des politiques en Europe. Centre d'Etudes de l'Emploi , n°40, 2000 http://www.cee-recherche.fr/publicationspdf/4p40.pdf
- HOLLOWAY, J., SIGAFOOS, J. La qualité de vie de jeunes adultes avec un handicap mental : une comparaison entre le milieu de travail ordinaire et l'emploi protégé. in : Revue européenne du handicap mental, 1998/12, vol. 5, n°20, 13-28
- HUNT, A. Nouvelles technologie et emploi des personnes handicapées. B.I.T. 1994 154, rue de Lausanne 1211 Genève 22 Suisse
- JAEGER, M. Du handicap à l'exclusion, des frontières brouillées. Esprit 1999, n° 259
- KERN, M. Les yeux aux bout des doigts. Editons de la Sarine 2001, Fribourg
- KEROUMI, B. Les techniques d'aménagement des postes de travail pour personnes handicapées visuelles. In : Les personnes handicapées et le marché du travail. Editions d'Organisation, 1995, 102-106
- KERROUNI, B. Les personnes handicapées et le marché du travail : un guide pour réussir. Les Editions d'Organisations 1995
- KONIG A., SCHALOCK R.L. L'emploi assisté : un peu plus d'égalité des chances pour les personnes gravement handicapées. Revue internationale du travail, 1991, 130 (1),23-31.
- LACOSTE-DEBRAY,V., MOUTON, E., RADISSON, M., ROSSIGNOL, M.P. Une expérience de stage d'accompagnement vers l'emploi en milieu ordinaire de travail pour adultes cérébro-lésés. Journal d'Ergothérapie 1997, 19, 1, 10-13
- LAINE, S. Le management de soi. Demos 2002
- LAMORY, N. De la volonté à la réalité d'emploi. La lettre de Garches 1992 11
- LAURENT, M. Place et évolution des UEROS au sein des CRP. READAPTATION, 2000, n° 469, 38-40
- Le guide du handicap. ESF 2002
- Le travail protégé en France : synthèse documentaire. CTNERHI 1995
- LECHAUX, P. L'employabilité des personnes handicapées. in : Réadaptation, 1999, n° 461, 26-29
- LEYMANN H., MOBBING. la persécution au travail. Seuil, Paris, 1996, 229p.
- L'insertion professionnelle des personnes handicapées. La documentation française. 1998
- L'intégration professionnelle des personnes handicapées : Le travail en milieu ordinaire. CTNERHI, dossier professionnel n° 5 2003
- LOURDAIS, M. Accompagnement lors du retours à l'emploi. La réinsertion socioprofessionnelle d'un patient traumatisé crânien. ErgOThérapie 2004, n°14, 17-36
- LUCAS, R. Les représentations du handicap visuel chez les employeurs. Le Valentin Haüy 2000, 60, 4-8
- LUNEAU, B. Informatique et réinsertion professionnelle. Communication au colloque :" Ergothérapie et nouvelles technologies", janvier 2003 Garches
- LYASID, M. Développer l'autonomie des personnes handicapées. Rapport au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 2000, 160 p
- MAGIS, M. Quelle méthodologie d'insertion professionnelle pour aider des personnes ayant une déficience visuelle ? Bulletin d'information des services de la Ligue Braille. 1997, 1
- MAILLET, J., PORTALIER, S., SARKISSIAN, L. Pour une guidance parentale précoce chez l'enfant aveugle ou amblyope profond de naissance. Neuropsychiatrie de l'enfance, 1987, 35, 7, 321-323
- MANDRAUD, I. Les handicapés restent aux portes des entreprises. Les échos 30 juin 1992
- MARTEAU, R. La sclérose en plaques et l'emploi. in : Revue médicale de l'assurance maladie, 1996, n°3, 76-84
- MARTIN, C., LAYOUS, A., DURAND J. La réinsertion des handicapés physiques en milieu rural. Journal d'Ergothérapie, tome 10, décembre 1988, n°4, Masson.
- MASSOT, P., LAGARDE, D., NASTADKA, P., BELLAÏCHE, M. ISO 9000-Mode d'emploi pour les PME. Editions AFNOR 2000.
- MENU, J.P. Vision et aptitude au travail. Editions techniques. Encycl. Méd. Chir. Toxicologie-Pathologie professionnelle, 16, 781-A-35, 1992
- MERCIER, M., BAZIER, G. Représentations sociales du handicap et de la mise au travail des personnes handicapées. In : Manuel de psychologie des handicaps : sémiologie et principes de remédiation. Sprimont : Mardaga, 2001, 510-532.
- MONTES J.-F. Travail infirme. Des aveugles travailleurs aux travailleurs handicapés. Genèse de la (re)mise au travail des infirmes. Paris, Université Paris I- Panthéon-Sorbonne, Centre d'éducation permanente, Mémoire de diplôme d'études supérieures en économie sociale. 1989.
- MOYSE, M. La formation professionnelle des travailleurs handicapés à l'AFPA. Réadaptation 1996, n° ; 427, 19-21
- MOYSE, M. Le temps, le précocité, la valeur travail. Communication au colloque "Bretagne Mieux Vivre Rennes 1995, 145-147
- O.M.S. L'emploi de la vision résiduelle chez les déficients visuels. Rapport et études européennes Copenhague 1982
- OUELLET, E. L'expérience d'un Webmaster aveugle. Journée thématique "Les enjeux d'Internet pour les personnes handicapées visuelles" Paris 1999
- PARIAT, M., ALLOUCHE, J. Guide de l'insertion sociale et professionnelle : formation continue et emploi, accompagnement éducatif et social, partenariat et territoires. Dunod 1998
- PETIT, H., WIART, L., DESTAILLATS, J.M., DEBELLEIX, X., MAZAUX, J.M., BARAT, M. Réinsertion professionnelle des traumatisés crânio-encéphaliques. In CODINE, P., BRUN, V. La réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Masson 1994
- PICAN, N. Poste de travail informatique et handicap visuel. Actes des 8 èmes entretiens de Garches. Blackwell 1995 pp217-218
- PIERRE, J-M. Le statut de travailleur handicapé : un mode social de gestion des précarités. Mémoire de maîtrise, UFR de sociologie, Université de Provence, Aix en Provence 1996.
- PIERRE, J-M. Travail, handicap et précarité. Handicap,2001, n° 89, 1-22
- PODESTA LE POITTEVIN, G. L'intégration professionnelle des personnes handicapées : notes sur les réflexions du Conseil de l'Europe. in : L'intégration des personnes handicapées : quelques éléments de bilan. Revue française des affaires sociales, 1998/03, n°1, 151-155
- PRUNET, J. Internet au quotidien pour un journaliste aveugle. Journée thématique "Les enjeux d'Internet p our les personnes handicapées visuelles" Paris 1999
- RASSOUW, D. Manager d'insertion. Syros 1995
- RAVAUD J.-F., VILLE I., JOLIVET A. Le chômage des personnes handicapées : l'apport d'une explication en termes de discrimination à l'embauche. Archives des maladies professionnelles, 1995, 56 (6),445-456.
- RAVAUD, J.F. Handicap et réinsertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. In CODINE, P., BRUN, V. La réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Masson 1994
- RAVAUD, J-F. Les aspects sociaux du handicap. Reconnaître, intégrer, respecter. Prevenir-CVM 2001
- RISSELIN P. Présentation succincte du dispositif des centres de rééducation professionnelle. (CRP), Revue française des affaires sociales, 1998, 52, 1/1998 (L'intégration des personnes handicapées : quelques éléments de bilan),131-132.
- ROUSSEL, P. Une estimation de la diffusion des aides techniques à partir de l'enquête HID de l'INSEE. Handicap, 2002, n° 96, 47-54
- SAMOY E., WATERPLAS L. L'Emploi protégé dans cinq Etats membres du Conseil de l'Europe : Autriche, Finlande, Norvège, Suède et Suisse. Strasbourg, Conseil de l'Europe. 1997.
- SANCHEZ, L. Actualité : durcissement des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées. SECURITE & MEDECINE DU TRAVAIL. LA REVUE DE L'AFTIM, 2006/03, n° 147, 10-13
- SAVY, J. et Coll. Intégration sociale et professionnelle des jeunes sourds. Réadaptation 1994
- SCHEPENS, C. L'adaptation fonctionnelle et la préparation à l'insertion des jeunes handicapés de la vue. Valentin Haüy 1999, 53, 26-29
- SCHEPENS, C. L'affectation professionnelle des handicapés de la vue. In "Préparation à la vie professionnelle, pour quelles perspectives?" XXVII èmes journées pédagogiques du groupement des professeurs et des éducateurs d'aveugles. Paris 1990
- SCHEPENS, C. Les aspects spécifiques de la formation professionnelle des personnes amblyopes. Communication aux journées de l'ALFPHV, Dijon 1993
- SCHWARTZ, M. Autonomie: but thérapeutique, professionnel, personnel. Journal d'ergothérapie 1991, 12, 2 34-35, Masson
- SIMONNEAU, M., COUVRET, J. L'entreprise et les handicapés. in : Liaisons sociales - supplément, 2001/10, n°13510, 90p
- SOBRY, E. La difficile réinsertion professionnelle des handicapés. in : Journal des psychologues, 2000, n°179, 57-60
- STIKER, H-J. Quand les personnes handicapées bousculent les politiques sociales. Esprit 1999, n° 259
- VELCHE D. Le travail des personnes handicapées en Europe: données comparatives. in APF-Formation (éd.), Handicap et Travail : Quel avenir pour les personnes handicapées (Acte du colloque des 13, 14 et 15 janvier 1997, Paris, palais de l'UNESCO), Paris, APF-Formation, 29-42.
- VELCHE D. Une spécificité française, le milieu de travail protégé ? in A. Blanc, H.-J. STIKER (éds), L'Insertion professionnelle des personnes handicapées en France, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, pp. 211-245.
- VELCHE D., CHAMPENOIS E., PERAZZO L., BOURDERON P. Enquête activité des EPSR. Résultats préliminaires de l'analyse des rapports d'activité, 1992. Paris, CTNERHI, (ronéoté.)
- VELCHE, D. Le travail protégé dans les quinze pays de l'Union Européenne. Handicaps et Inadaptations - Les cahiers du CTNERHI 199 5, N° 65-66, 21-30
- VELCHE, D. L'emploi des personnes handicapées : accompagner la transition vers un nouveau modèle ? in : Handicap, 2000/10-12, n° 88, 43-69
- VELCHE, D. Les politiques d'emploi des personnes handicapées dans l'Union Européenne. in : Les aspects sociaux du handicap : reconnaître, intégrer, respecter. Prévenir, 2000/07-12, n°39, 167-172
- VELCHE, D. Réinsertion professionnelle en milieu protégé. In CODINE, P., BRUN, V. La réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Masson 1994
- VERRY, V, Baptiste R, et al. Vulnérabilité psychique et emploi. Pratiques en Santé Mentale 2004 ; 50(4) : 3-54.
- VIAL, M. Se former pour évaluer, se donner une problématique et élaborer des concepts. De Boeck Université, 2001
- VIARD, A. Centre régional d'études et d'actions sur les handicaps et les inadaptations. (C.R.E.A.I.). Lyon. La loi de rénovation de l'action sociale au quotidien. Paris : L'Harmattan, 2006
- VILLE, I. Le travail des personnes handicapées : une voie incontournable pour l'insertion ? in : Les aspects sociaux du handicap : reconnaître, intégrer, respecter. Prévenir, 2000/07-12, n°39, 179-184
- VINCENT, P. Malvoyants: La bureautique. Science et technologie 1991, N° 34
- VISIER L. Les Relations de travail en milieu protégé. Genève, BIT, Cahiers de l'emploi et de la formation, 1998, n° 22.
- ZRIBI, G. L'avenir du travail protégé : centres d'aide par le travail et intégration, Rennes : ENSP, 1998, 118p. réf. 4p
- ZRIBI, G. L'avenir du travail protégé. CAT et intégration. ENSCP 1998


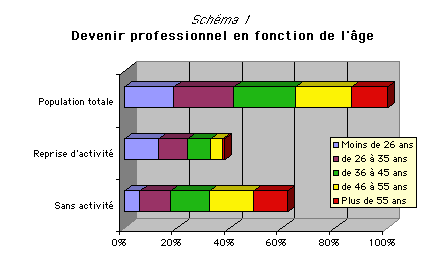
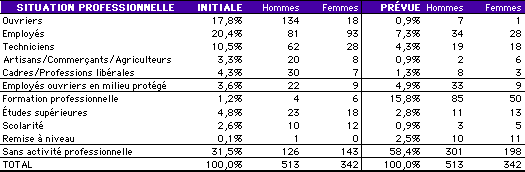
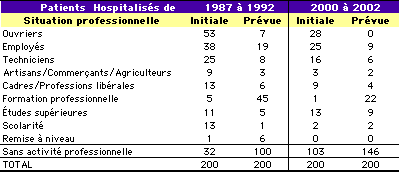
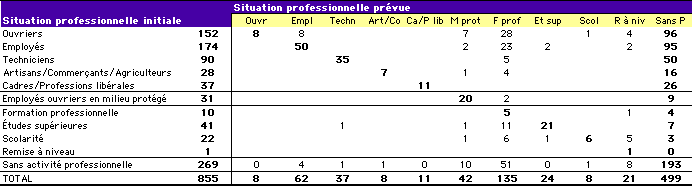

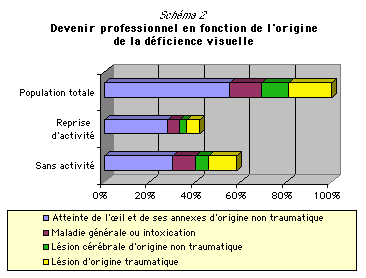 De même, on constate que les patients pour qui la déficience visuelle est acquise au cours de la vie ont un pronostic de reprise d'activité significativement plus faible, au vu de notre population (schéma 5) que dans les cas où la déficience est congénitale ou acquise avec une participation héréditaire. Dans ces cas, le taux de prévision de reprise d'activité est meilleur. La sur-représentation des patients ayant une pathologie congénitale parmi ceux qui pensent reprendre une activité est la plus marquée (un sur deux pense retravailler ou suivre une formation). En effet, ces patients entreprennent une rééducation au cours de leur vie alors qu'ils sont déjà, pour nombre d'entre eux, en situation professionnelle ou en cours d'études. La rééducation n'est dans la perspective professionnelle qu'un atout supplémentaire ou un moyen de rebond et d'adaptation ou de diversification de l'activité. De plus, dans un grand nombre de cas, et principalement pour les patients porteurs d'une déficience visuelle acquise avec une participation héréditaire, l'aggravation de la déficience se produit de manière progressive étalée, uniformément ou par poussées, au long de la vie ou du début de la vie d'adulte.
Cela suppose que :
De même, on constate que les patients pour qui la déficience visuelle est acquise au cours de la vie ont un pronostic de reprise d'activité significativement plus faible, au vu de notre population (schéma 5) que dans les cas où la déficience est congénitale ou acquise avec une participation héréditaire. Dans ces cas, le taux de prévision de reprise d'activité est meilleur. La sur-représentation des patients ayant une pathologie congénitale parmi ceux qui pensent reprendre une activité est la plus marquée (un sur deux pense retravailler ou suivre une formation). En effet, ces patients entreprennent une rééducation au cours de leur vie alors qu'ils sont déjà, pour nombre d'entre eux, en situation professionnelle ou en cours d'études. La rééducation n'est dans la perspective professionnelle qu'un atout supplémentaire ou un moyen de rebond et d'adaptation ou de diversification de l'activité. De plus, dans un grand nombre de cas, et principalement pour les patients porteurs d'une déficience visuelle acquise avec une participation héréditaire, l'aggravation de la déficience se produit de manière progressive étalée, uniformément ou par poussées, au long de la vie ou du début de la vie d'adulte.
Cela suppose que :